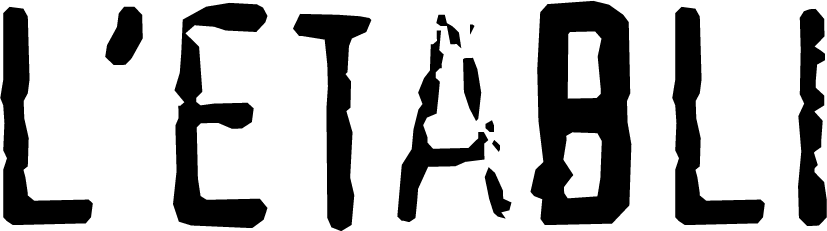Miroslav Popovic
Les Vauriens de Tito, Belgrade, 1988,
trad. du serbo-croate par Pascale Delpech,
Christian Bourgois, 1991.
Les Vauriens de Tito, Belgrade, 1988,
trad. du serbo-croate par Pascale Delpech,
Christian Bourgois, 1991.
Ces cinq témoignages sur la terrible purge des partisans du Kominform par le régime de Tito après sa rupture avec Moscou sont, de tous les récits que j’ai pu lire sur les exterminations, enfermements, tortures, broyages des humains par des régimes tortionnaires, les plus désespérants, non pas que les sévices y soient plus graves qu’ailleurs, mais le système mis en place pour réduire les hommes y est plus intentionnellement cruel, plus malveillant s’il se peut établir des hiérarchies de la malveillance. Les hommes, “vauriens” amenés au plus bas de leur humanité par toutes les pressions physiques et les perversités discursives de la domination, sont poussés à se faire les bourreaux des “vauriens” placés plus bas qu’eux-mêmes dans l’échelle officielle de l’ignominie.
Dans le premier de ces textes, Composition, je lis une illustration du deleatur, ce signe de correction typographique qui a pour nom une formule latine : “à détruire”. Dans Composition est montré à l’œuvre le deleatur radical de toute réalité par le retournement perpétuel et à une rapidité ahurissante des versions officielles de l’histoire. Le socle le plus mince où asseoir sa raison est constamment détruit. L’effet, peut-être même pas sciemment escompté, c’est de pousser les esprits au-delà de la détresse, dans la défaite accomplie par avance, à l’intérieur du désespoir.
“L’année 1948 pour ceux qui ne s’en souviennent pas est aussi éloignée que 1848 ou que toute autre année quarante-huit. C’est humain. Avant nous — le déluge.
Les jeunes ne souhaitent pas particulièrement se replonger dans cette période. Ils se ruent vers ce qui est nouveau et inconnu, sans que le passé les gêne. C’était il y a bien longtemps et ils n’y étaient pas. Ils ne se doutent bien sûr pas que l’année 1948 n’est nullement révolue. Que le calendrier s’y est arrêté. Que toutes ces années ne sont que les saisons d’une seule et même année sans fin. Le printemps, l’été, l’automne, l’hiver. Répétés à l’infini.”
Ce texte date de 1988 : avant la guerre de Bosnie. Miroslav Popovic y donne une analyse culturelle des premières victimes de ces purges : les Serbes et les Monténégrins parce qu’ils sont russophiles, les Slovènes par discipline et lenteur d’adaptation à la nouvelle doxa, les Dalmates (qui sont croates) à cause de leur goût du débat politique.
Des Macédoniens, au contraire très peu nombreux à avoir été soupçonnés de sympathies pour Staline, Popovic écrit : “c’était la première fois qu’ils étaient reonnus en tant que nation et ils en étaient heureux”.
Le second texte, Le Crayon, est une réflexion sur la castration. Une réflexion très proche de celle où Chalamov, dans ce long récit de la Kolyma qui s’intitule Le Gant, passe en revue, derrière l’Utopie de Thomas More, les quatre besoins vitaux castrés dans le camp : la nourriture, la sexualité, la miction, la défécation, pour ajouter un cinquième besoin vital de l’humanité en racontant la très belle histoire des nuits poétiques de la salle de soin du service chirurgical : les échanges littéraires, les récitations poétiques, la convocation des auteurs immenses, se passent dans la salle où sont soignés les corps opérés.
Le Crayon
“Le rêve culturel de tout prisonnier était un crayon. Pas un grand crayon tout neuf, sentant bon la librairie, lisse, jaune… Mais minuscule. Facile à cacher. Un trognon.
Le rêve était interdit. Par la direction de la prison. Sévèrement.
Mais pourquoi y rêvait-on ? Pourquoi les gens se retrouvaient-ils au cachot à cause d’un petit bout de graphite ? La réponse est : parce qu’il n’était pas indispensable pour survivre jusqu’au lendemain. C’est le propre de l’homme, il s’y accroche, s’y accroche jusqu’à ce qu’il soit emporté par les courants de l’indispensable et définitivement expédié dans le monde des bêtes.”
Le quatrième des cinq textes est le récit effroyable d’un Lynchage auquel le narrateur doit, contraint par les autres détenus et pour sa propre survie, prendre part, et il s’agit de mettre à mort, à mains nues et dans les cris et les slogans scandés, Vlasta, son ami.
“À partir de là, mes souvenirs sombrent complètement. Que se passa-t-il et combien de temps cela dura-t-il ? Je ne m’en souviens pas.
[…]
Puis, tout à coup, une image surgit.
Puis, tout à coup, une image surgit.
La cour du camp. Le rectangle des baraques. Peintes. Blanches. Le cailloutis blanc. Les deux rangs sinueux du corridor. Face à face.
L’image baigne dans un éclairage impitoyable. Jusque dans les moindres recoins. Si bien qu’il n’y a pas de recoins.
[…]
Le soleil était complètement blanc.
Le soleil était complètement blanc.
Au cours de ma détention, j’ai vécu également des moments terribles sous un ciel sans soleil, trouble, brouillé, scélérat…[…]
Mais lorsque j’imagine le comble de l’horreur, c’est toujours sous le ciel de l’été. Pas chaud. Pas frais non plus. Ces choses-là ne sont pas importantes. On en les remarque même pas. Mais plutôt implacablement blanc.
[…]
Le dense “A-mort-le-vaurien !” dégénéra soudain à cet endroit en un hurlement prolongé.
Je tendais le cou vers la porte d’où étaient sortis les chefs des baraques.
Le dense “A-mort-le-vaurien !” dégénéra soudain à cet endroit en un hurlement prolongé.
Je tendais le cou vers la porte d’où étaient sortis les chefs des baraques.
Je ne comprenais pas que Vlasta était le centre de ce groupe et le hurlement le signe qu’il avait été poussé dans le corridor.
De notre côté on continuait à hurler : “A-mort-le-vaurien !” je tapais des mains en rythme. Et j’ouvrais la bouche comme si je scandais les slogans.
De notre côté on continuait à hurler : “A-mort-le-vaurien !” je tapais des mains en rythme. Et j’ouvrais la bouche comme si je scandais les slogans.
Puis je compris enfin.
Je ne vis Vlasta que lorsqu’il fut à une quinzaine de mètres de moi. Dans un méandre du corridor.
Il sautillait de façon comique.”
Je ne vis Vlasta que lorsqu’il fut à une quinzaine de mètres de moi. Dans un méandre du corridor.
Il sautillait de façon comique.”